Silent Hill 2
’In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you’d take me there again some day. But you never did. Well I’m alone there now... In our "special place"... Waiting for you...’
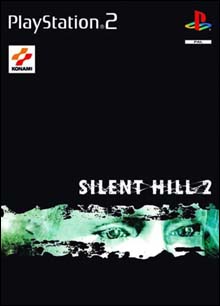 La présence dans les pages de SdA d’un article consacré à un jeu vidéo vous surprendra peut-être... Pourtant, si vous faites partie de notre lectorat fidèle, vous aurez sans doute remarqué que, à chaque fois - ou presque - que je m’attaque à un film d’horreur récent, je me débrouille pour caser une ou deux éloges, plus ou moins discrètement, sur ce chef d’œuvre qu’est Silent Hill 2. Pourquoi un tel acharnement ? Je vous le demande aussi...
La présence dans les pages de SdA d’un article consacré à un jeu vidéo vous surprendra peut-être... Pourtant, si vous faites partie de notre lectorat fidèle, vous aurez sans doute remarqué que, à chaque fois - ou presque - que je m’attaque à un film d’horreur récent, je me débrouille pour caser une ou deux éloges, plus ou moins discrètement, sur ce chef d’œuvre qu’est Silent Hill 2. Pourquoi un tel acharnement ? Je vous le demande aussi...
Et puis, il y a de cela trois jours, à l’occasion de la mise en ligne d’un article concernant le magnifique Los Sin Nombre de Jaume Balaguero, un ami a repéré une de ces phrases extrêmes qui fait bondir un lecteur sur deux : "Silent Hill 2 est (à mes yeux, bien sûr) le meilleur film d’horreur des dix dernières années". L’ami en question, un tantinet outré, me fait remarquer qu’il serait bien que j’explique, une fois pour toute, pourquoi je me livre sans cesse à de telles affirmations concernant ce qui n’est, à premier abord, qu’un simple survival horror de plus. Alors voilà. Etant donné qu’à mes yeux, Silent Hill 2 est un véritable film bien plus qu’un simple jeu, et qu’en plus il a été réalisé au Japon par des japonais, je me permets d’inclure cette déclaration d’amour morbide dans les pages de SdA. Welcome to Silent Hill...
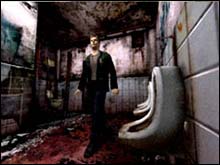 Avant de m’attaquer au jeu en lui-même, c’est du film d’horreur (dans sa généralité) dont nous allons parler. Paradoxe cinématographique historique, le cinéma d’épouvante, comme on l’appelle aussi, fut l’un des premiers genres "grand public" du siècle dernier, avec l’explosion des films dits de monstres, signés Universal Pictures dans les années 30. Aujourd’hui, c’est un genre "ghettoisé", tristement privé de représentants sur grand écran. Comment expliquer un telle décadence du genre qui a fait le succès d’Universal, mais aussi de la Hammer, des écuries Corman et j’en passe ? Ce n’est pas évident, et bon nombre de facteurs sont à prendre en compte. Pour résumer, on pourrait dire que le genre s’est condamné par un auto-mimétisme démesuré. La fameuse "sclérose" du film d’horreur, si vous préférez. Et ce, sans aucun doute grâce à (ou à cause de, rétroactivement) l’apparition de la vidéo. Ainsi chaque sous-genre horrifique s’est-il, au cours des trois dernières décennies, condamné à l’extinction : le gore par le biais de ses propres excès, le giallo et le slasher par manque de profondeur narrative, le film de monstre par simple absence de renouvellement d’un bestiaire éculé... Un peu à l’image du western dont les réalisateurs fers de lance semblent avoir définitivement fait le tour à force de vouloir le revitaliser, le film d’horreur s’est épuisé trop vite. Le cas des slashers en est la plus belle illustration...
Avant de m’attaquer au jeu en lui-même, c’est du film d’horreur (dans sa généralité) dont nous allons parler. Paradoxe cinématographique historique, le cinéma d’épouvante, comme on l’appelle aussi, fut l’un des premiers genres "grand public" du siècle dernier, avec l’explosion des films dits de monstres, signés Universal Pictures dans les années 30. Aujourd’hui, c’est un genre "ghettoisé", tristement privé de représentants sur grand écran. Comment expliquer un telle décadence du genre qui a fait le succès d’Universal, mais aussi de la Hammer, des écuries Corman et j’en passe ? Ce n’est pas évident, et bon nombre de facteurs sont à prendre en compte. Pour résumer, on pourrait dire que le genre s’est condamné par un auto-mimétisme démesuré. La fameuse "sclérose" du film d’horreur, si vous préférez. Et ce, sans aucun doute grâce à (ou à cause de, rétroactivement) l’apparition de la vidéo. Ainsi chaque sous-genre horrifique s’est-il, au cours des trois dernières décennies, condamné à l’extinction : le gore par le biais de ses propres excès, le giallo et le slasher par manque de profondeur narrative, le film de monstre par simple absence de renouvellement d’un bestiaire éculé... Un peu à l’image du western dont les réalisateurs fers de lance semblent avoir définitivement fait le tour à force de vouloir le revitaliser, le film d’horreur s’est épuisé trop vite. Le cas des slashers en est la plus belle illustration...
En effet, lorsque Wes Craven se lance dans la réalisation du premier Scream, c’est avec l’expérience et l’intelligence d’un réalisateur qui, aux côtés de John Carpenter, a contribué à lui donner ses lettres de noblesse. Rien d’étonnant du coup à ce qu’il se livre à un décorticage en règle des postulats du slasher pour le remettre à la sauce teenager fin de siècle... L’intelligence du premier Scream résidait donc dans son talent à mettre à jour la simplicité stupide du fonctionnement des films de psycho-killers tout en l’appliquant une fois de plus, à la lettre. Craven a d’ailleurs réussi à duper l’intégralité de son public. C’est sans doute pour cette raison qu’il s’est autorisé à livrer un second opus reprenant ce même fonctionnement comme si le premier Scream l’avait réellement inventé. Le troisième épisode, souvent critiqué et pourtant le plus intéressant de la trilogie, va beaucoup plus loin dans l’auto réflexion, faisant exploser le hors-champ si cher au cinéma fantastique pour offrir un mea-culpa sous forme d’aveu cinématographique. Un geste suicidaire de la part de Craven qui condamne le genre à se mordre la queue à jamais.
 Revenons un peu sur ce fameux hors-champ - l’un des éléments-clefs de la peur au cinéma -, que l’on pourrait presque définir, dans sa conception moderne, comme étant le véritable lieu de l’horreur. C’est en tout cas ainsi que l’ont utilisé la majorité des réalisateurs italiens - Dario Argento en tête - mais aussi Carpenter, De Palma,...
Revenons un peu sur ce fameux hors-champ - l’un des éléments-clefs de la peur au cinéma -, que l’on pourrait presque définir, dans sa conception moderne, comme étant le véritable lieu de l’horreur. C’est en tout cas ainsi que l’ont utilisé la majorité des réalisateurs italiens - Dario Argento en tête - mais aussi Carpenter, De Palma,...
Aux Etats-Unis, la plupart des réalisateurs ont tendance à l’exploiter différemment, comme délimitation d’un cadre dont l’horreur surgit. Mais l’horreur s’y déroule rarement, et l’on aboutit au seul véritable substrat du film d’horreur contemporain : le sursaut, réflexe cognitif plus que réaction primale. Ces dernières années, on a donc préféré au hors-champ dans sa conception seventies ce que l’on pourrait appeler un "hors-champ dans le cadre", cette fameuse notion de flou cinématographique qui consiste à montrer des choses non-explicitées, à développer l’inconnu à la base même de la peur pour mieux la susciter. Seulement, cet inconnu finit toujours par être explicité ; et le film d’horreur bascule alors dans le fantastique, refusant généralement de plonger le spectateur dans un malaise durable.
Comment faire alors pour revenir à la peur véritable ? La solution Blair Witch Project, elle aussi très critiquée, est loin d’être si absurde qu’on le prétend, tout simplement parce qu’elle est authentique et fait appel au véritable hors-champ - à savoir l’imagination. Mais on sait qu’il existe d’autres manières de susciter la terreur chez le spectateur. Massacre à la tronçonneuse en restera éternellement l’illustration.
Si Massacre à la tronçonneuse est aujourd’hui considéré comme un film "démonstratif", cette qualification le catégorise trop souvent dans le gore. Hors, le chef-d’œuvre de Tobe Hooper ne montre finalement que très peu d’hémoglobine et de chairs outragées ; il est démonstratif car l’horreur y est montrée en plein jour, avec insistance. Dans un tel cas, elle est explicitée, dans le sens où la source de notre terreur est parfaitement identifiée. Est-ce que l’on la comprend pour autant ? Est-ce que l’on est capable de prédire son évolution comportementale ? Bien au contraire. Renforcé par l’utilisation d’une bande son faite de fréquences appelant une réponse physique incontrôlable, Massacre à la tronçonneuse recrée donc intelligemment les conditions nécessaires à l’obtention d’un cauchemar programmé et éveillé. C’est sûrement pourquoi il reste aujourd’hui considéré comme le film d’horreur le plus "pur" qui soit.
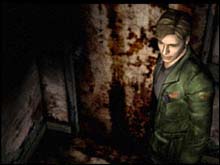 Et Silent Hill 2 dans tout ça ? Vous me pardonnerez mes digressions, mais je pense que les paragraphes précédents étaient nécessaires pour évaluer les qualités de ce jeu hors du commun.
Et Silent Hill 2 dans tout ça ? Vous me pardonnerez mes digressions, mais je pense que les paragraphes précédents étaient nécessaires pour évaluer les qualités de ce jeu hors du commun.
La technique de Massacre à la tronçonneuse, étrangement, n’a presque jamais été reproduite au cinéma (ou alors sans succés). Sans doute est-ce justement parce qu’elle crée un malaise véritable. Cette notion d’ "horreur explicitée et pourtant incompréhensible" fait justement la force de Silent Hill 2, qui parvient à utiliser toutes les définitions du hors-champ telles que décrites précédemment pour revenir à cette conception "durable" de l’horreur.
Au début de l’aventure, James Sunderland reçoit une lettre de sa femme, l’invitant à la rejoindre dans un lieu chargé de souvenirs pour le couple. Mais comment est-ce possible, quand on sait que Mary est décédée deux ans auparavant ? James décide tout de même d’en avoir le cœur net, et se rend donc à Silent Hill. Sa quête débute dans des WC crasseux, alors qu’il tente de s’accrocher à sa propre réalité par le biais de son image dans le miroir. Ce reflet est-il vraiment le sien ? Que dissimule l’épais brouillard qui flotte sur la ville ?
Son périple continue. Au détour d’une impasse, James croise une créature indéfinissable, qui se contorsionne comme sous l’effet de chocs électriques... Cauchemar éveillé, réalité déformée ou encore perception altérée ? Là n’est pas la véritable interrogation de James... mais Mary peut-elle vraiment se trouver dans cette ville ?
 Dés le départ, Silent Hill 2 va bien plus loin que Scream dans l’explicitation de ses propres règles. La première cinématique du jeu présentant une créature, invite James à pénétrer hors-champ, dans une espèce de tunnel. Au flou du brouillard se substitue la pénombre de l’endroit semi-fermé, au fond de laquelle semble se mouvoir une bien étrange entité. Le hors-champ devient donc présent mais flou à son tour, avant d’être éclairé et explicité. Cependant, la créature qui s’offre à nos yeux ne ressemble à rien de connu. Son apparence est une moquerie, une perversion d’un physique humain, corrompu. Ses déplacements gardent un semblant de mobilité humaine mais n’obéissent à aucun modèle physique connu (la créature rappelle d’ailleurs les hallucinations de Tim Robbins dans L’échelle de Jacob).
Dés le départ, Silent Hill 2 va bien plus loin que Scream dans l’explicitation de ses propres règles. La première cinématique du jeu présentant une créature, invite James à pénétrer hors-champ, dans une espèce de tunnel. Au flou du brouillard se substitue la pénombre de l’endroit semi-fermé, au fond de laquelle semble se mouvoir une bien étrange entité. Le hors-champ devient donc présent mais flou à son tour, avant d’être éclairé et explicité. Cependant, la créature qui s’offre à nos yeux ne ressemble à rien de connu. Son apparence est une moquerie, une perversion d’un physique humain, corrompu. Ses déplacements gardent un semblant de mobilité humaine mais n’obéissent à aucun modèle physique connu (la créature rappelle d’ailleurs les hallucinations de Tim Robbins dans L’échelle de Jacob).
L’effet de peur traditionnel est remplacé par un effet de fascination durable : tant que la créature est à l’écran, la peur est sucitée. Elle ne disparaît pas avec la pénétration du hors-champ dans le cadre. C’est donc la formule Massacre à la tronçonneuse qui est appliquée avec merveille, car le fait de montrer la créature ne fait pas pour autant basculer le jeu dans le simple fantastique. Et il en sera de même tout au long du jeu : James continuera à rencontrer des créatures toutes plus effrayantes les unes que les autres, toutes identifiables et pourtant incompréhensibles. L’acceptation de leur présence ne renvoie pas à une quelconque explication.
Comme nous avons affaire à un jeu, tout de même, on peut observer un mécanisme aussi intéressant que pervers... Déjà dénoncée par Craven dans le premier Scream, on retrouve cette faculté des personnages à aller s’enfermer au premier étage alors qu’ils pourraient sortir par la porte de derrière et s’enfuir. Ou encore à aller tout seul à la cave, avec une lampe de poche dont tout le monde sait que les piles sont presque vides. Sommes-nous vraiment plus intelligents que ces personnages fictifs ? Ici, le joueur est obligé d’aller voir ce qui se passe hors-champ, puis d’affronter tout ce qu’il ramène dans le cadre, sans jamais le comprendre : il est donc contraint à affronter complètement la peur, à la regarder en face. On se retrouve même parfois obligé de se plonger volontairement dans l’obscurité totale, un comble !
 Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Silent Hill 2 ne livre jamais la clé de cette terreur. Si la fin du jeu apporte une conclusion au cauchemar, elle n’en justifie pas pour autant le contenu. Et c’est là toute la différence entre Silent Hill 2 et les films d’horreurs modernes, mais aussi les autres survival horror, tels que les Resident Evil - qui fonctionnent pour leur part, comme la majorité des films américains, sur des sursauts désirés. L’horreur est palpable et visible ; le joueur peut identifier son adversaire mais ne peut jamais le comprendre, pas plus qu’il ne peut être certain d’en venir à bout. Le hors-champ de Silent Hill 2 demeure éternellement celui de l’imagination en dépit de demonstrations horrifiques incessantes. C’est pourquoi le cauchemar de Silent Hill 2 ne s’arrête jamais, tout comme celui de Marilyn Burns dans Massacre à la tronçonneuse.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Silent Hill 2 ne livre jamais la clé de cette terreur. Si la fin du jeu apporte une conclusion au cauchemar, elle n’en justifie pas pour autant le contenu. Et c’est là toute la différence entre Silent Hill 2 et les films d’horreurs modernes, mais aussi les autres survival horror, tels que les Resident Evil - qui fonctionnent pour leur part, comme la majorité des films américains, sur des sursauts désirés. L’horreur est palpable et visible ; le joueur peut identifier son adversaire mais ne peut jamais le comprendre, pas plus qu’il ne peut être certain d’en venir à bout. Le hors-champ de Silent Hill 2 demeure éternellement celui de l’imagination en dépit de demonstrations horrifiques incessantes. C’est pourquoi le cauchemar de Silent Hill 2 ne s’arrête jamais, tout comme celui de Marilyn Burns dans Massacre à la tronçonneuse.
Magnifiquement réalisé, accompagné d’une partition superbe et désespérée, et faisant un usage pernicieux d’infra-basses dérangeantes, Silent Hill 2 propose au joueur/spectateur de s’infliger une trouille soutenue, interminable, assénée avec toujours plus d’insistance.
Du coup, je me suis peut-être trompé en déclarant que Silent Hill 2 est le meilleur film d’horreur des dix dernières années. Pour moi, c’est plutôt le meilleur en trente ans ! Le plus beau, le plus triste, le plus poignant, le plus... Okay, je m’arrête là... pour aujourd’hui ! On s’écrit dans deux ans...
Silent Hill 2 n’est pour l’instant disponible que sur Playstation 2, accompagné d’un DVD de suppléments (making-of, bandes annonces,...).


















